
Peut-on sourire du 11 novembre ? Le respect, la décence, le bon goût voudrait que non. Ce jour est un jour particulier pour la mémoire des victimes de la Grande Guerre. Je vis le 11 novembre avec reconnaissance et émotion, notamment parce que je sais, fils de pupille de la Nation, ce que la mention « mort pour la France » sur un monument et une sépulture veut dire, intimement, personnellement. Rien n’est plus fort, plus émouvant, plus pénétrant même, que ce sentiment d’être lié à l’histoire d’une guerre par l’absence et le sacrifice d’un aïeul. Pourtant, le magnifique roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, et son histoire d’une arnaque aux monuments aux morts, nous a appris aussi qu’une part de légèreté, certes respectueuse, n’était pas inappropriée. Cela fait du bien de sourire, sans rien enlever à la reconnaissance de la tragédie et des souffrances, ni à la nécessaire dignité qui l’accompagne. J’écris cela en préambule de l’histoire que je m’apprête à raconter pour qu’elle soit comprise et placée dans un juste contexte. Je me suis demandé si je devais la partager et j’ai finalement pensé que oui, je le pouvais. Il y a quelques témoins qui, s’ils lisent ces lignes, s’en souviendront encore. Ils avaient ri à gorge déployée à l’époque et moi aussi d’ailleurs, quoi que, sur l’instant, tout ne fut pas si drôle.
C’était le 11 novembre 2007, autant dire il y a longtemps. J’étais l’un des élus des Français de Belgique à l’Assemblée des Français de l’étranger. Avec mes collègues, nous avions pour habitude de retrouver chaque 11 novembre les autorités diplomatiques françaises, les représentants des forces armées belges, le Bourgmestre de Bruxelles et les associations patriotiques pour raviver la flamme du Poilu Inconnu au pied du Monument aux morts à Laeken. Cette année-là, en 2007, je m’étais dit que je pouvais changer de plan et me rendre à Liège pour un même hommage, organisé dans les carrés militaires du cimetière de Robertmont. Près de 1000 soldats y sont inhumés. La cérémonie de Liège est partagée avec les belges, les italiens, les pays du Commonwealth et les russes. En mon nom et en celui de mes collègues élus, je devais déposer une couronne dans le carré français. Rendez-vous avait été fixé … derrière le crématorium. C’était déjà un peu sinistre. Surtout, il tombait des cordes et le vent soufflait en tempête. Mon modeste parapluie ne survécut que quelques minutes aux éléments déchainés. Le Consul général de France arriva en retard, essoufflé et trempé de la tête aux pieds. Il avait crevé dans la montée vers le cimetière et changé sa roue sous la pluie battante.
Le signal du départ donné, notre procession du souvenir s’engagea dans les allées du cimetière. Le carré militaire français était le dernier par lequel nous devions passer. Nous nous arrêtâmes d’abord dans les carrés belges et italiens. Plus nous avancions, plus les allées devenaient des chemins débordant d’une boue épaisse. Il pleuvait depuis longtemps. Ce n’était pas la chance, ni le jour des chaussures cirées desquelles, bien sûr, je m’étais équipé. Entre les tombes moussues et des montagnes de feuilles mortes glissantes, pataugeant tant bien que mal, je ne pouvais m’empêcher de penser à Petula Clark et à sa chanson La Gadoue. Personne n’avait de bottes. Dans chaque carré militaire, un petit louveteau en short et chemisette, transi de froid et trempé, devait hisser les couleurs au moment où retentissait l’hymne national du pays. Le vent était si fort que la musique en était inaudible. Le louveteau tirait avec souffrance sur sa corde. Dans le carré français, le drapeau n’arriverait même pas en haut du mat. Le moment était solennel, mais il avait aussi quelque chose de lourdement pathétique, entre ces enfants grelottant de froid et de fatigue, se demandant sûrement ce qu’ils faisaient dans une telle galère, et les officiels que nous étions, préoccupés surtout de ne pas se casser la figure entre les pierres tombales.
A mesure que nous avancions, chacun était de plus en plus crotté. Vint enfin le carré militaire français. J’avais l’impression que la tempête avait redoublé de vigueur. Nous dégoulinions de pluie. Le représentant des anciens combattants français, qui allait bon pied bon œil sur ses 90 ans, dérapa dans l’allée et roula sous nos yeux dans la bouillasse. Avec le Consul, nous entreprîmes de le relever et le réconforter. Plus de peur que de mal, mais notre arrivée devant le monument se fit de ce fait en ordre dispersé. La procession ne nous avait pas attendus. La sono crachota une Marseillaise lointaine et chevrotante. Le vent sifflait. Tout partait en quenouille. Lorsque mon tour vint de déposer ma couronne, je m’aperçus que je portais celle des anciens combattants. La mienne avait disparu ou avait été déposée par quelqu’un d’autre. Le Consul cherchait la sienne. Les gens qui avaient accompagné la procession jusqu’au bout n’avaient qu’une envie : filer au plus vite se sécher et se mettre au chaud. C’était aussi mon idée, me demandant pourquoi je n’étais pas resté à Laeken comme mes autres collègues élus. Gentiment, le Consul me proposa de passer chez lui sur les hauteurs de Cointe pour prendre un café revigorant. J’acceptai bien volontiers. Je pensais que ce serait la fin de l’aventure. Il n’en fut rien.
Le café et les gâteaux avalés, il me tardait de reprendre la route pour rejoindre Bruxelles. La pluie n’avait pas cessé. Je me sentais humide jusqu’au bout des chaussettes. Sur l’autoroute, une trentaine de kilomètres après Liège, ma voiture fit un bruit étrange, qui bientôt devint continu, alors même que j’éprouvais de plus en plus de mal à garder le contrôle. Je dus me rendre à l’évidence qu’il m’arrivait la même chose qu’au Consul le matin sur la route de Robertmont : une crevaison. Je me retrouvais promptement sur la bande d’arrêt d’urgence, le cric à la main sous le déluge, prenant sur la figure les bordées d’eau projetées tels des paquets de mer par les voitures qui me frôlaient. C’est peu dire que l’on se sent misérable en un moment pareil. Après Petula Clark et sa chanson, c’est irrésistiblement à Pierre Richard et à son film La Chèvre que je pensais, dans une digression maudite sur la poisse, tentant de changer ma roue, préoccupé aussi de ne pas me faire heurter par quelques chauffards lancés à toute allure sur l’A3 comme s’ils étaient à Francorchamps. J’y arrivai au prix d’une douleur soudaine au bas du dos. Quelque chose s’était coincé. Une vieille tante bretonne que j’aimais beaucoup appelait cela un tour de rein. Cassé en deux, je grimpai tant bien que mal dans ma voiture pour rallier enfin Bruxelles.
Cette aventure m’a valu une semaine d’arrêt médical, les remontrances amusées de mon médecin et la franche hilarité de mes autres collègues élus de Belgique à l’Assemblée des Français de l’étranger. A Laeken, il n’était en effet tombé que quelques gouttes. Les couronnes et gerbes déposées, la flamme ravivée, ils étaient allés de l’autre côté du parvis prendre un café, et peut-être même l’apéro, alors que pour moi, quelques heures après, ce serait plutôt le grog, en plus des médocs à haute dose. Voilà, c’était il y a 16 ans. Le temps a filé depuis et il y a amplement prescription. Je crois qu’il fallait que j’écrive cette histoire avant qu’elle ne s’efface. Mieux vaut en rire. Que ne fait-on pas tout de même, lorsque l’on est élu, m’avait-on dit alors ! C’est vrai ! Elu, je ne le suis plus aujourd’hui, mais je continue tous les ans de me glisser dans la petite foule de la cérémonie du 11 novembre, mon Bleuet de France à la boutonnière. Le moment m’émeut chaque fois. Je ne peux cependant m’empêcher de penser à cette aventure de 2007, toujours nichée dans un coin de ma mémoire. Ce souvenir du 11 novembre n’est guère solennel, je le reconnais volontiers, mais il m’accompagne malgré tout. Samedi matin, j’irai à Laeken. Il faudra un jour que je retourne aussi à Robertmont. Je n’y suis plus allé depuis 2007. L’an prochain, peut-être.
Commentaires fermés

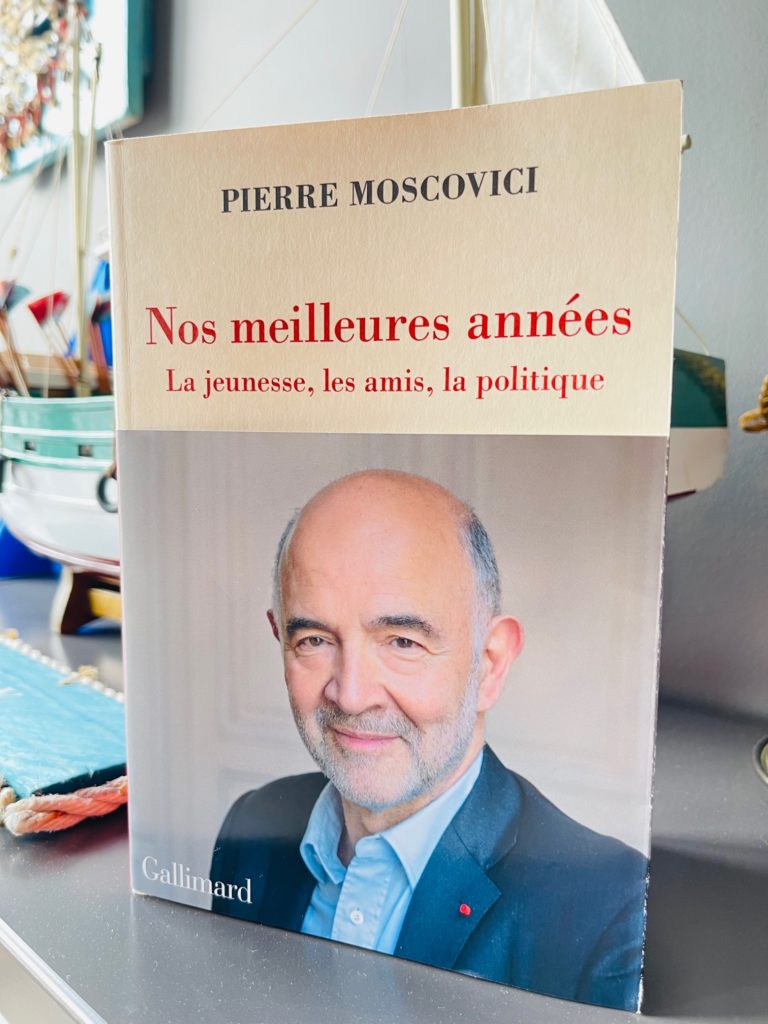
Rester soi-même
Cette photo ancienne prise le 11 novembre 2016 face aux Bouches de Kotor (Monténégro) pourra peut-être surprendre. Ce fut ma dernière commémoration officielle comme parlementaire. Je me souviens de ce moment pour cela, mais davantage encore pour le tourment qui était le mien en cette fin d’année 2016. Mon père, très souffrant, vivait ses dernières semaines et nous étions, ma mère, ma sœur et notre famille, profondément affectés par cette épreuve intime. Il fallait vivre cependant et je poursuivais tant bien que mal mes activités de député des Français de l’étranger, à Paris et en circonscription. Mais ce 11 novembre 2016, mon tourment était aussi politique. Quelques jours auparavant, Donald Trump avait été élu Président des Etats-Unis. En France, nous venions de traverser deux années terribles, marquées par les attentats terroristes de Charlie Hebdo, du Bataclan, de l’Hyper Casher et de Nice. L’état d’urgence était en place. Politiquement, la majorité parlementaire ne cessait de se désagréger. La proposition de déchéance de nationalité française présentée par François Hollande m’avait choqué. Elle allait à l’encontre des valeurs pour lesquelles je m’étais engagé dans la vie politique. Les deux minutes d’expression dans l’Hémicycle pour dire que je m’y opposerais furent les plus dures de mon mandat.
Je n’ai jamais aimé être un Cassandre. Je crois en la force du collectif, en la capacité d’agréger des parcours et des idées, parfois différentes, parfois même opposées. Ce fut l’histoire du Parti socialiste depuis son congrès d’Epinay en 1971, et davantage encore après les Assises du socialisme et l’arrivée de Michel Rocard en 1974. Ce fut également l’histoire de l’UMP, le parti de la droite française constitué par Jacques Chirac et Alain Juppé en 2002 par la réunion des gaullistes du RPR, des libéraux de DL et des démocrates-chrétiens de l’UDF. Un corps d’idées, un socle de valeurs et de principes unissait les membres, les militants et sans doute aussi une large part des électeurs. Je n’ai jamais vécu la vie politique comme un combat sans merci, une lutte contre des adversaires qu’il faudrait nécessairement haïr, battre, écraser. Je n’aime pas l’expression de clivage droite-gauche, non pas parce que je me défierais des différences – je suis un homme de gauche – mais parce que je récuse l’expression « clivage », qui sous-entend l’existence d’une frontière séparant irrémédiablement les gens. Je crois avant tout en le respect bienveillant des différences, qui sont saines et estimables, et que je crois par ailleurs dépassables pour les causes qui doivent rassembler, parmi lesquelles l’avenir du pays, de ses institutions et de la démocratie.
En politique, il faut pouvoir rester soi-même. L’union ne peut se faire à contre-emploi, en reniant ce à quoi l’on croit, parfois depuis toute une vie. Le dépassement a son sens – j’ai voté pour Emmanuel Macron – mais il ne peut être en même temps un effacement des valeurs et des principes propres à un idéal ou à un courant de pensée. Ce n’est pas ainsi que l’on fait l’union. Je ne pouvais faire mienne en 2016 la proposition de déchéance de nationalité car elle heurtait le principe d’égalité entre les citoyens qui m’est cher par-dessus tout : je ne suis pas davantage français que mes enfants binationaux et je l’avais dit dans l’Hémicycle de l’Assemblée nationale. Fondamentalement, je ne pense pas que l’on soit crédible à porter des propositions que l’on désapprouve personnellement, sauf à verser dans le cynisme, le calcul et l’indifférence à l’égard des électeurs. Ce n’est même pas tant que l’on ait pu prendre position quelque temps auparavant contre une proposition que l’on défendrait désormais, c’est d’abord que l’on ne peut juste pas se regarder en face et se dire avec conviction que ce changement s’inscrirait dans le sens logique des choses. Je crois qu’il y a une sincère noblesse à connaître ses lignes rouges et à ne pas les dépasser, pour protéger le débat politique et se protéger également.
J’écris tout cela aujourd’hui parce que deux évènements intervenus ces derniers jours m’ont marqué. Le premier est la disparition de l’aide médicale d’Etat (AME) votée par le Sénat dans le projet de loi sur l’immigration. Si j’étais encore député, je ne pourrais en aucune manière voter en faveur de la suppression de l’AME. Je ne crois pas que l’AME crée un quelconque appel d’air en faveur de l’immigration illégale en France. Rien n’empêche de faire évoluer la législation française sur l’immigration dans le sens voulu par le gouvernement sans toucher pour autant à l’AME. L’accès aux soins médicaux relève de l’humanité la plus élémentaire, de l’égalité entre citoyens bien sûr, mais aussi et peut-être même avant toute chose de préoccupations de santé publique. La volonté du Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin d’aller chercher par la suppression de l’AME une majorité avec la droite à l’Assemblée nationale pour faire adopter le projet de loi heurte profondément mes convictions. Je n’ai pas le souvenir que le candidat Emmanuel Macron portait un tel projet en 2017 et en 2022. Il portait même l’inverse. Je ne pense pas que l’on puisse à ce point se renier et je serai attentif comme électeur au choix de la majorité parlementaire et des députés. La politique ne peut être un situationnisme, une glissade indolore au fil de l’eau.
Le second évènement qui m’a interpelé est l’investiture de Pedro Sanchez à la Présidence du gouvernement espagnol grâce au soutien des députés indépendantistes catalans. Il fallait à Pedro Sanchez les voix des députés du parti indépendantiste catalan Junts pour gagner ce vote. Il y est parvenu, au prix de la promesse d’une loi d’amnistie à l’égard des dirigeants catalans de 2017, dont il disait quelques mois auparavant qu’il ne saurait aucunement en être question et qu’elle serait même anticonstitutionnelle. Fallait-il ainsi charger d’avis, du tout au tout, pour conserver coûte que coûte le pouvoir ? Pour un Européen de ma génération, a fortiori à gauche, la référence en Espagne reste Felipe Gonzalez et son opposition à l’accord de Pedro Sanchez avec Junts est assumée. Lorsque je faisais campagne pour le mandat de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe au Parlement espagnol en 2018, le souci commun au PSOE et au PP de préserver le cadre institutionnel et l’esprit de la transition démocratique espagnole m’avait impressionné. Ces sujets-là requièrent en effet une concorde nationale, une volonté de dépassement. La fracturation de la société espagnole est un défi redoutable, qu’un autre choix que celui de l’alliance avec les indépendantistes aurait permis de réduire : celui du rassemblement, certes inédit, du PP et du PSOE, de 2 Espagnols sur 3, pour refonder le pacte constitutionnel.
La vie politique dans nos démocraties minées par le doute et la perte de confiance citoyenne souffre que rien ne soit clair, que tout devienne relatif et que l’on défende demain ce que l’on a combattu hier. Je reviens à cet automne 2016, à mes propres doutes. Je ne pouvais me faire à l’idée de porter dans un autre mandat, présidentiel et parlementaire, un projet actant la fin du travail, le doute face à l’innovation et à l’entreprise, le renoncement à l’Europe. Je pressentais que c’est ce vers quoi allait le Parti socialiste. J’ai fait un choix et il m’a coûté ma vie politique. J’en ai souffert, mais je ne regrette rien. Je n’ai pas changé, avec mes convictions, avec mes limites certainement aussi. Depuis l’automne 2016, je pense souvent à mon père, à ce qu’il aurait pensé ou dit. J’ai besoin de cette référence qu’il fut pour moi et qu’il demeure par-delà l’absence. Peut-être n’aurait-il pas fait tous mes choix. Ou bien peut-être que si, après tout. Sur la réforme des retraites, son regard m’aurait importé. Il était attaché à la retraite à 60 ans, mais il n’ignorait pas les réalités du monde qui vient non plus. De lui, je tiens l’attachement à l’honnêteté dans le débat d’idées et dans l’action, une forme de boussole juste et rassurante lorsque tout est complexe et rude, le souci d’expliquer, de convaincre et de se laisser convaincre. Et, plus que tout, de ne jamais cesser de chérir ce à quoi on croit, en un mot, en effet, de rester soi-même.
Commentaires fermés