
Je suis un enfant des années 1970. J’ai le souvenir des petits transistors qui grésillaient. Il y en avait plusieurs chez nous. Je me souviens de l’un d’entre eux, tout orange, sur lequel mon père avait écouté en direct la finale de la Coupe du monde de football de 1974. Nous étions dans un parc à Tours. Il ne fallait pas le déranger. C’était juillet, j’avais 9 ans et ma sœur 7 ans. Ces petits transistors ont marqué mes premières années. On ne captait pas toujours bien la station de radio, les chansons ou les informations. Il fallait tendre l’oreille, jouer sur la mollette, parfois même déplier une petite antenne. J’aimais les transistors l’été lorsqu’ils donnaient les nouvelles de « la route du Tour ». Et souvent aussi l’état des bouchons sur une route dont on parlait tout le temps, mais que je ne connaissais pas : la Nationale 7. De temps en temps, chez l’une ou l’autre de mes grands-mères, je voyais à la télévision des images en noir et blanc de cette route. C’étaient de longues files de voitures, les unes après les autres, avançant au pas ou n’avançant pas du tout. Sur les toits, il y avait souvent des valises. Les gens roulaient vers les vacances et ils étaient nombreux. Pour nous, en Bretagne, c’était exotique. Ils allaient dans le Midi, une destination lointaine, vaguement incertaine pour moi, et que je devinais chaude.
C’est comme cela que la Nationale 7 est entrée dans ma vie, sans que jamais nous ne l’empruntions. Je ne suis allé sur la Nationale 7 que longtemps après, à l’âge adulte. Elle était désormais reléguée. Les vacanciers lui avaient préféré les autoroutes construites dans l’intervalle. J’ai emprunté la Nationale 7 sur quelques dizaines de kilomètres, jamais davantage. Il n’y avait plus de bouchons, mais les platanes étaient encore là, l’esprit des vacances aussi et la chanson de Trénet également. Ce devait être merveilleux de rouler vers le sud, de Paris vers Menton, ou vers Sète aussi. Et inversement tellement déprimant d’en revenir, vers le nord, les vacances finies. Jusqu’à hier, j’avais toujours roulé seul sur la Nationale 7. Je n’avais eu personne à qui confier cette émotion guère explicable, venue de si loin, de ces jeunes années et des souvenirs de nos petits transistors grésillant sous le soleil de l’été. Mais hier, revenant de Savoie avec ma famille, je me suis aperçu que nous étions tout près de la Nationale 7. Je n’y avais pas pensé plus tôt. Je l’ai prise et, peu à peu, j’ai commencé à partager ces images lointaines, à mesure que nous avancions entre les villages, les collines et les grands arbres. Pour mes enfants, arrachés aux DVD qui trompent la monotonie de l’autoroute, mes histoires étaient peut-être étranges.
J’avais retenu des chambres dans un petit motel à proximité de Pouilly-sur-Loire. Il s’appelle le Motel Les Broussailles. Je le recommande volontiers : confortable, accueillant et subtilement rénové. Où dîner ? A la réception du motel, il me fut proposé un petit relais à l’entrée de Pouilly. La nuit était tombée. Mes jeunes skieurs, du fond de la DS, criaient famine. Va pour le petit relais. Quelques kilomètres plus loin, dans l’obscurité, je vis apparaître une vieille station-service. Ce ne pouvait être là. Mais si, c’était bien là. Nous allions dîner dans l’une des stations mythiques de la Nationale 7, celle du kilomètre 200, là où l’on faisait le plein du réservoir, celui de l’estomac aussi, et où l’on pouvait également passer la nuit. La station-service a certes été restaurée, mais elle a conservé un charme délicieusement kitsch, depuis les serviettes assorties aux rideaux vichy rouges et blancs jusqu’aux murs tapissés de vieilles affiches automobiles et aux étagères garnies de vieux bidons d’huile de vidange et de voitures miniatures. Voilà comment, après avoir raconté la Bourgogne et la Loire un peu plus tôt, je me suis retrouvé, devant les assiettes de blanquette de veau, à expliquer ce qu’étaient Castrol, Mobil ou Champion. Je ne suis pas certain d’être apparu irrésistiblement moderne, mais suffisamment authentique malgré tout pour que mes enfants s’amusent de tous les souvenirs qui me revenaient en pagaille.
Le hasard fait bien les choses, finalement. Au relais Les 200 Bornes, nous étions servis. Qui se souvient de l’émission Les routiers sont sympa ? Il faut sans doute être à tout le moins quinquagénaire pour cela. Le signe était là, face à moi, à la table du restaurant, et j’ai encore la voix de Max Meynier à l’oreille. Il y avait aussi le panonceau bleu et rouge des relais Les Routiers. Mon père adorait ces restaurants des bords de route et je nous y vois encore avec lui, ma mère, ma sœur et moi, devant une table toujours garnie d’une nourriture solidement roborative. Je crois que c’est le côté populaire de ces restaurants qui lui plaisait. De tout cela aussi, j’ai raconté hier l’histoire à ma petite équipe. En y ajoutant les souvenirs de nuits passées dans d’improbables hôtels de sous-préfecture, Au Lion d’Or ou Le Cheval Blanc le plus souvent, avec les lits qui grinçaient, et les toilettes et les douches sur le palier. C’était réellement un autre temps, mais vous savez quoi, ai-je ajouté, c’était vraiment bien. J’ai la mémoire peuplée de ces images et je me suis retrouvé, à Pouilly, à partager ces émotions, juste parce que nous avions emprunté une route mythique et que la recommandation de notre hôtel nous avait conduit par chance dans un endroit qui l’incarnait mieux que tout.
La France est tellement plus belle le long des nationales et des départementales que depuis les aires et restaurants d’autoroute. Il faut oser sortir de ces autoroutes, accepter d’aller moins vite, choisir de prendre le temps et – acte d’autorité doucement exercé – décréter que les tablettes et autres écrans ne sont définitivement pas compatibles avec les chemins de traverse. Il faut prendre le temps d’admirer la France et l’aimer comme elle vient, dans la diversité des paysages et des saisons. L’an passé, au retour des montagnes, nous étions allés à Vézelay, par les petites routes vallonnées du Morvan, vers cette colline éternelle qui m’émeut chaque fois davantage et rapproche tellement de Dieu. Nous avions cherché aussi les lieux de tournage de La Grande Vadrouille, car il ne faut pas oublier que le rire fait partie de notre patrimoine (et qu’il transcende les générations). Cette année, c’était la Loire d’avant les châteaux, le fleuve encore sauvage venu du Massif central, glissant entre les vignobles, les îles, les champs et les bois vers la mer encore lointaine. Et demain, dans quelques mois, l’années prochaine ? Nul ne le sait encore. J’essaierai de trouver. Cluny peut-être, Solutré, Bibracte, le Mont Beuvray. Une chose est sûre : nous recroiserons la Nationale 7 et l’emprunterons à nouveau avec bonheur.




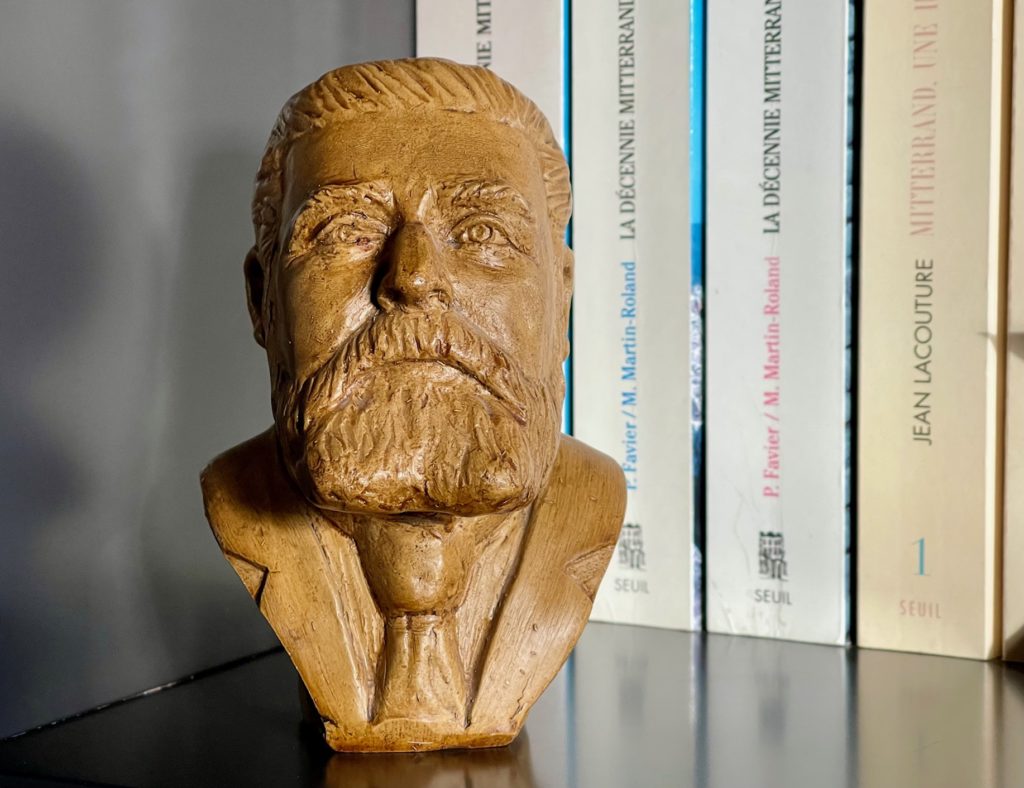
Libres !
La photo en illustration de ce post aura bientôt 6 ans. C’est celle du temps paisible d’avant le Covid, d’avant la guerre en Ukraine, d’avant l’ébranlement redoutable du monde. Les petits personnages qui couraient vers l’océan dans la lumière du mois d’août ont bien grandi depuis lors. Ils voient venir l’adolescence. Les amoureux de la Bretagne reconnaîtront la chapelle de Saint-They et la Pointe du Van. Plus à l’ouest, on ne trouve guère sur le littoral français. Quelques bons milliers de kilomètres plus loin, ce seront les côtes canadiennes et américaines. J’aime cette pointe et ce Cap Sizun qui, tel une étrave, s’enfonce fièrement dans l’Atlantique. Sur les falaises, dans le vent, depuis ma jeunesse, j’y ai toujours ressenti un sentiment enivrant de liberté. De la Pointe du Van ou de la Pointe du Raz, j’ai voulu imaginer, longtemps avant de les découvrir, ce qu’étaient les rivages de l’autre côté, avec le sentiment que cet océan nous était commun et qu’il scellait entre nous un destin partagé. Je n’ai jamais vu l’Atlantique comme une fin, je l’ai toujours vu comme une union. C’était bien avant que je m’intéresse à la géopolitique et aux choses du monde. Ce sentiment ne m’a jamais quitté. Je devais être un petit finistérien atlantiste par intuition. J’y repense souvent depuis que le monde est devenu sombre.
J’aime passionnément la liberté. Je ne conçois pas de vie heureuse sans liberté. Je venais d’avoir 25 ans lorsque le Mur de Berlin est tombé. Ce moment m’a marqué à jamais. J’exécrais le totalitarisme communiste, les Etats prisons, la police de la pensée. J’espérais que s’instaure un âge d’or de la démocratie, qui dure longtemps, toujours peut-être. Je rejetais tout aussi vivement le fascisme, les dictatures d’extrême-droite, la haine, le racisme, la bigoterie. Je suis un démocrate par passion. Il y a de la place pour chacun dans une société de liberté. La liberté, c’est l’Etat de droit. La liberté, ce n’est pas la jungle, la loi du plus fort, celle des grandes gueules ou des brutes épaisses, de Trump ou de Poutine. Je crois à la Constitution, à la nôtre en France, et à celles des autres aussi. Je crois à la justice constitutionnelle. On n’écarte pas une Constitution en vertu des circonstances, de l’ivresse de la puissance, de l’idée qu’un succès électoral permettrait tout. Je crois aussi à la séparation des pouvoirs qui nous protège, nous les citoyens. Celui qui gouverne n’est pas celui qui fait la loi. Et celui qui juge ne gouverne ni ne légifère. Tout cela, c’est l’Etat de droit, dans lequel je glisse le droit international et le droit européen aussi. Ces convictions m’ont construit. Je n’y renoncerais à aucun prix.
Précisément, la liberté n’a pas de prix. Elle ne s’achète pas par une quelconque vassalisation. Elle se défend par la force. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’il faille baisser la tête, tout accepter, à commencer par le pire, par crainte de la guerre. Poutine menace l’Europe par opposition à la liberté. Il ne veut pas de la liberté. Il est un dictateur qui sait trop bien qu’une société libre, où la personne humaine serait respectée dans sa dignité, scellerait la fin de son régime. Il asservit pour se protéger, pour régner et terroriser. C’est à la liberté qu’il fait la guerre, et si tout au bout il pouvait peut-être y avoir la paix, ce serait pour lui sans la liberté, à l’exclusion de celle-ci. Pour Trump, la liberté, c’est seulement la sienne. Celle des autres, il s’en moque. C’est sa liberté de menacer, d’insulter, d’annexer, d’abandonner, de trahir. Le discours de J.D. Vance à Munich le 14 février m’a révulsé. Comment pouvons-nous accepter de nous faire faire la leçon sur la liberté d’expression ? Ce discours était une agression brutale, vulgaire et indigne à l’égard des démocraties européennes. La liberté, ce n’est pas le mercantilisme des GAFA, ce n’est pas celle de mentir et de désinformer à tout crin sur les réseaux sociaux, à l’abri de toute vérification des faits et réalités, désormais proscrite.
La période est moche. Elle l’est d’autant plus que résonne chez nous le concert des opportunistes, des populistes et des pleutres. Les médias de Bolloré annoncent, jouissifs, la victoire prochaine de Poutine et la droite extrême les suit avec jubilation. A l’extrême-gauche, l’anti-américanisme de LFI emporte tout, la liberté de l’Ukraine, celle de l’Europe, 70 années et plus de construction d’un espace de prospérité, pour un soi-disant non-alignement ne dissimulant guère la soumission à l’arbitraire et peut-être même une fascination pour lui. Le bolivarisme n’aime pas la liberté. Or, c’est la liberté, encore et toujours, qu’il faut défendre, qu’il faut promouvoir, même si c’est dur, parce que c’est dur. Je tiens aux valeurs européennes, à celles de cette communauté euro-atlantique qui unit les deux rives de l’océan et qui m’est chère parce que nous avons, envers et contre tout, la liberté, la démocratie, l’égalité, les droits de l’homme en partage. Durant des années à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, j’ai vu combien ces valeurs avaient un sens, combien elles fédéraient, par-delà les soubresauts et les tragédies de l’histoire. Je n’oublie aussi aucun de ceux qui sont tombés pour la liberté et à qui nos générations doivent des décennies de paix. Ma famille sait ce que ce sacrifice signifie.
Il n’y a pas de fatalité à l’effacement de la liberté, à l’illibéralisme. L’Europe est face à son destin. C’est son heure, c’est maintenant ou jamais. Poutine ne s’arrêtera pas à l’Ukraine. Trump voudra démanteler l’Europe. Ne cédons rien, ni à l’un, ni à l’autre. L’union politique de l’Europe est son plus grand atout. Il faut s’y accrocher, la développer, réarmer militairement notre continent parce que c’est par la force que l’on défend la liberté. C’est un effort massif et urgent en faveur de leurs capacités de défense auquel nos pays et nos sociétés doivent consentir. L’autonomie stratégique de l’Europe est la condition de sa survie. L’Ukraine doit en être parce que l’Ukraine, c’est l’Europe. Ce qui se joue là-bas, à Kiev, à Kharkiv, à Odessa, est notre avenir de pays et de peuples libres, notre maintien dans l’histoire. Dans le débat public, il ne faut surtout pas se taire face à tous ceux qui nous pressent de renoncer, de nous faire petits, d’oublier l’Europe et même de l’abhorrer. Il faut au contraire argumenter, convaincre, lutter. En abandonnant l’Ukraine, en s’alignant grossièrement sur le narratif de Poutine, Donald Trump a mis l’Europe en mouvement. C’est peut-être la meilleure leçon à retenir, pour nous assurément, pour lui éventuellement aussi. Il n’est jamais trop tard pour nous vouloir passionnément et fièrement libres.
Commentaires fermés